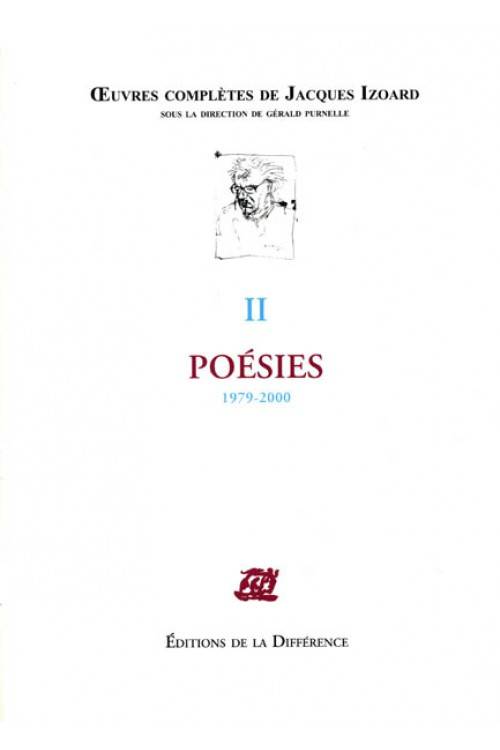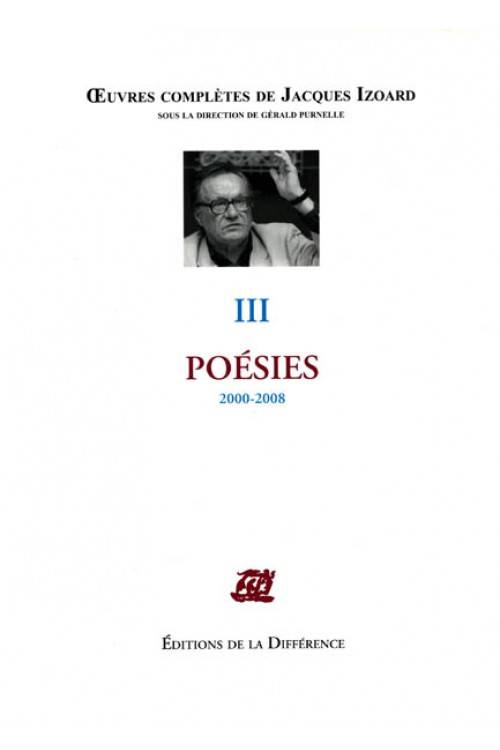Jacques Izoard

J’assassine un rêve en ouvrant les yeux.
Jacques Izoard… Un nom. Un prénom. Une œuvre. Un homme…
Ce jour là, je cherchais un cadeau pour mon frère et je traînais dans l’allée poétique de « La Réserve », cet antre qui me ressemble, en regardant les piles, les « dos carrés », les titres… Il y avait une « masse » blanche surmontée d’un livre en équilibre où je pus lire, au centre, un grand « I » surmontant le titre « POÉSIES 1951 – 1978 ». En surtitre, il y avait cette mention : « Œuvres complètes de Jacques Izoard » …
Nous étions fin 2006 et noël approchait. Je ne savais rien de ce Jacques Izoard dont le premier volume trônait face à moi. Je ne savais rien de cet homme qui écrivait depuis plus de cinquante ans et devait, sans aucun doute, puisqu’on publiait son « œuvre complète », être quelqu’un « d’important », quelqu’un que j’aurais dû connaître, que j’aurais dû avoir lu si je n’avais ce rapport étrange à la « culture », à « l’establishment » qui fit de moi un autodidacte en (presque) tout.
J’ouvris le volume au hasard puis me mis à le feuilleter… Un premier regard sur des strophes courtes, des mots choppés d’un coup d’œil, la main soupesant l’œuvre – dense, lourde –, et je lus :
Buvez ma violence et que le doux temps
Dont l’usure est dans l’horloge
Soit par nos mains purifié.
Or ma langue a pesé la neige
Et la neige a des miroirs fins
Que ma Venise humilie ou abroge.
O mon automne, est-ce ici
Que tu vas consumer ton feuillage ?
En haut de la page, il y avait marqué « Aveuglement Orphée » comme un renvoi à ma propre histoire. Le texte était présenté « brut », sans glose. Une évidence. Je ne sais d’où venait cet étrange sentiment d’une œuvre familière, je ne pouvais m’en défaire et tournais quelques pages encore pour lire, en lire plus :
Aucun lien n’unit
La parole à l’oubli,
Si ce n’est ce corps
Et son chemin toujours possible
Et son attente infinie.
J’avais mon cadeau ! J’avais bien plus en fait. Je pris le volume I, le volume II, pour mon frère, puis le volume II pour moi puisqu’il n’y avait plus de volume I disponible (forcément, je le commandais) et rentrais chez moi avec mon « paquet » à offrir et ce Jacques Izoard à découvrir.
Inévitablement, j’attendis la semaine suivante ; il me fallait commencer par le début. A-t-on jamais vu remonter le temps et lire le dernier avant le premier ? En fait, j’aurais pu. Mais « Aveuglement Orphée » était dans le tome 1 et je n’avais qu’une hâte : finir ce texte. Ce que je fis. Mot à mot. Vers à vers. Strophe à strophe. Pas à pas comme un promeneur. Non. Un randonneur. Les sentes étaient pleines d’eaux vives, de rochers, de chausse-trapes :
Odradek est mon nom secret. Je pulvérise l’oubli pour descendre sous la terre, sous mon ombre.
Travail sur la mémoire. Anamnésie ! Hétéronymie ! Comment avais-je pu passer à côté ? Il y avait sur cette page blanche noircie de signes une voix, grave, profonde, qui s’élevait et me touchait là où peu m’avaient touché. Une force. Une nature. Une pierre dressée, menhir, indiquant le centre et le cercle. J’étais à cent mille lieux de cela, avant, de cette écriture, ce fluide, de ce regard sur le monde mêlant l’homme à la chair de la terre :
Faut-il toucher la nuit,
Le va-et-vient des loutres
Quand les mains les caressent
Ou cousent la lenteur des sexes ?
Faut-il toucher l’émerveillement
De la mort des oiseaux ?
Jacques Izoard mettait des mots là où j’aurais été incapable de même voir, simplement voir. J’avais déjà ressenti cela avec Philippe Jaccottet et ses paysages. Je le retrouvais ici, plus loin, dans d’autres pages, avec le canal de l’Ourthe, Liège la nuit. Tout ce que le « bucolisme » apporte au « romantisme », s’il faut parler par chapelle…
Mais, plus loin, si la vision du monde est différente, le monde est le même, fait d’éléments qui nous échappent, après quoi nous courrons. Au premier degré, le mien, l’homme et sa grande gueule. Celui qu’on tend à écouter. Celui qu’on montre dans sa beauté, sa nudité, son horreur aussi.
Plus haut, la vision d’Izoard des forces qui l’entourent. Passage de « l’homme complexe » à « l’homme noyau » du système atomique qui est notre aujourd’hui, comme l’aurait (peut-être) écrit Edgar Morin, comme Izoard ne l’écrira pas mais le sera, plus tard :
Que commence en furie
Cet éclatement, cette secousse
Qui frappent et secouent
Le corps tout entier,
Le corps empêtré
Dans l’autre corps
Qu’on avait oublié !
Alors, je posai le livre, il me fallait l’apprivoiser si je ne voulais pas m’y noyer. Au pied de mon fauteuil, tous les jours, tous les soirs, je voyais les deux tomes se fondre peu à peu dans mon quotidien. Parfois, j’ouvrais au hasard l’un ou l’autre volume, comme un missel connu par cœur, et lisais un vers, une strophe, à chaque fois brutale, à chaque fois cette descente vers l’ombre de l’homme où l’homme est en miroir.
Evidemment je me rapproche
Des objets que la rouille aime,
Des osselets autour du cou,
Des mots dont on fait les poèmes,
Et de moi-même
Oui, je me rapprochais de moi-même à travers cet autre inconnu quelques temps avant. En marge du « Manteau de pauvreté », n’avait-il pas écrit : « La poésie est pour moi le moyen de vivre mieux et plus longtemps dans l’épaisseur des choses. Je me sens solidaire des objets qui m’entourent ; plus ils veulent m’éviter, plus j’ai tendance à me rapprocher d’eux. » C’est ce que je faisais en laissant ces livres à portée de main, je me rapprochais de l’objet poétique. J’y découvrais des récurrences, recueil après recueil. L’eau, la terre, le feu, l’air, éléments telluriques entourant un centre éther qui n’était qu’amour :
Ton corps est fait de chair et d’aube
Et je dois délier tes caresses
Pour que se fasse en toi le pur sommeil
Ton rêve est fait de lourds marais
Où la nuit met sa solitude
Et je dois garder mes gestes
Pour ce jour qui naît de l’ombre
Mais le temps coule au fond du puits
Et des oiseaux sans nombre
Battent des ailes près de ton lit
Le titre de ce recueil « Les sources de feu brûlent le feu contraire » me renvoyait au Nord, aux mines, à la forge d’Héphaïstos où l’homme naît de la fusion. Car tout n’est que fusion. Son texte, mon passé. Je commençais à prendre des notes, à la marge, sur cette belle marge laissée par l’approche strophique d’Izoard. J’écrivis des mots & des noms : assonances, rythmes, héritage, parenté (Soupault, Apollinaire, Bonnefoy, Neruda), éloignement (Aragon, Eluard, Maïakovski, Llorca) … Je découvrais des liens photographiques, des instants figés et pourtant mobiles, et je dessinais des courbes entre les mots, des passages d’une strophe à l’autre, sorte de tunnel ou de voies pour me conduire inexorablement vers ce que je croyais être la compréhension de l’œuvre et qui n’était, somme toute, qu’une autre plongée en « terra incognita ».
J’ai suivi ce sentier débroussaillé par Jacques Izoard. Il avait tourné autour, marché vers, marché avec ses éléments telluriques qui ne le quittaient jamais : l’eau, bien sûr, cette eau de l’Ourthe qui le traversait, cette eau parfois bleue, parfois vive, la terre, l’air ou le feu qui était colère, comme poings levés ! Chacun de ces éléments m’envahissait, tour à tour, tous en même temps, figure la vie, et me laissait « le goût pourpre des cendres / vives en cet été que la mort désagrège ».
Je t’aimais pour l’ocre
Et pour les ténèbres
D’un lieu fugace,
Celui où tu cachais
Ton étroit talisman,
Où les broussailles mangent
La moindre clarté.
Et je l’ai rencontré !
J’avais le fil, les répons, l’ordre de la parole – car tout n’est que parole –, il ne me restait plus qu’à écrire, à partager ce coup de poing qu’il m’avait fallu attendre plus de quarante ans. Restait seulement la question du comment. Comment écrire ce souffle parcourant le siècle pour m’atteindre ? Comment décrire mon ignorance ? Comment donner tout ce que je venais de recevoir ?
J’aurais pu parler thématiques : l’eau, le feu, la terre, l’air, l’homme, la femme, la ville, Liège, le jardin – ordonné à la française où nu et sauvage de l’abandon de l’homme –, les hiboux, la nuit, l’attente, le feu, l’eau, la vie, le corps, le sexe, l’amour, la poésie, l’enfance, Dieu, les yeux, la terre, l’eau, le feu… A m’y perdre ! Reproduire ces dessins qui, maintenant, griffaient mon édition. Travailler les « sur lignages » et gloser comme le maître d’école devant l’œuvre qu’il ne comprend pas.
Il aurait fallu alors repérer les occurrences, les allitérations, les liens, les vers où se mêlent, ou se maillent tel ou tel sème :
Le Christ
Le garçon devient le soir
Et le soir s’ensable en cherchant sa proie
Pour quel pour quel désir de feu ancien
Viens-tu dans l’or que j’incendie
O Mercure agenouillé devant moi
Garçon vêtu de soie blasphème
Blasphème ce sosie
Ton sosie attaché à la croix
Mais alors ? Qu’aurais-je fait de plus que classifier l’inclassable ? La poésie peut-elle être ainsi décortiquée ? Peut-on, grâce à une liste d’ingrédients, en reproduire le goût ? En connaître la recette ? L’alchimie du verbe peut-elle se résumer à une simple liste d’ingrédients ? Non. Je ne le crois pas. Compter les voyelles et les consonnes d’un vers de Mallarmé ne permettra jamais d’en reproduire l’ultime beauté.
Alors ?
Je décidais de vous embarquer sur ce fleuve qu’est l’œuvre de Jacques Izoard. Un fleuve qui traverse quarante ans de tumultes sûr de sa sérénité, tranquille en ses remous, posé là de toute éternité, quitte à changer de lit, quitte à se raidir, à s’assécher, à plonger sous terre pour apprivoiser son ombre. Un fleuve né de cette eau qui doute d’être l’eau…
L’eau doute
Est-elle eau
La terre écoute
Et le feu souffre
De sa brûlure
Et cet homme
Est-il homme
Ou le nul impossible ébahi
L’homme est doute
Et le feu souffre
La terre écoute
Et l’eau est-elle au
Thentique
Ce voyage, nous pourrions le faire en calèche, en express – c’est une question de style – mais Izoard l’a décrit en piéton, en randonneur, alors flânons, marchons, avec lui, que nos regards soient du même rythme que le regard qu’il posa sur le monde. Accélérons le pas quand le feu brûle, arrêtons nous pour humer l’air d’alentour, baissons nous pour comprendre « l’eau sur la main qui franchit la lumière », couchons nous sur cette terre « aux chemins désireux de tenir l’été trouvé dans les bleus maritimes », cette terre qui se lie à l’espace, cette terre de boues, de blés, de rocs et de roches (selon qu’elle saigne ou qu’elle tue) et ralentissons nos souffles pour nous souvenir de l’autre, cet autre qui nous ronge et que l’on déploie dans chacun de nos gestes.
Alors ?!
Je serre mon poing
Dans la main d’un autre.
Mon poing à la figure
Mon poing à l’écriture.
Mon poing à la confiture.
Mon poing à l’échancrure
D’un béat corsage.
Je serre les poings
Pour ne point mourir.
Et puis ?!
Accueille en toi le vide
Et de ce vide emplis
Cœur, œil ou ventre,
Et les secrètes cavités
De par le corps entier.
Plus léger que l’air
Parle alors à voix basse.
Le temps s’arrêtera.
J’appris alors la mort de Jacques Izoard comme j’avais ignoré son existence ; avec plusieurs semaines de retard. En fait, ironie, en bouclant les notes pour ce texte. En parlant de lui avec mon frère, du choc que j’avais ressenti, de l’envie que j’avais de le rencontrer, il me dit, doucement : « mais, tu sais, il est mort… ».
Je suis resté avec ses textes, griffonnés de mes scories, m’emplissant de cette colère qui parcourt ces cinquante ans de poésies, qui glisse le long de l’Ourthe, qui arpente le cœur et le corps de l’homme comme, j’imagine, Jacques Izoard arpentait les rues de Liège, de Rome ou d’Espagne. Que restait-il à dire ?
Tout dire et ne rien dire…
Conter l’enfance
Au fond de l’eau,
Couper les tranches
De la vie enfarinée…
D’émeute en émeute
Hausser le ton.
Et que l’azur éclate !
Oui ! Que l’azur éclate !
Oui ! Que l’azur éclate !