Voix vives
De méditerranée en méditerranée
(2011 – 2020)
J’aime à lire des anthologies comme j’aime à lire des revues. Pour moi, c’est la même chose. L’anthologie consacre des auteurs marquants lorsque la revue découvre de nouveaux talents. Enfin normalement, puisque nombre de revues affichent à leurs sommaires des « têtes d’affiches » et quelques anthologies, notamment celles consacrées à la poésie contemporaine, intègrent des auteurs qu’il reste à découvrir.
L’une comme l’autre procèdent de l’art délicat de l’équilibre. La répartition des espaces, le nombre de convives, le choix des textes, les transitions lorsqu’elles existent, les références biblio-biographiques. Toute cette subtilité n’a pour buts que d’offrir un panorama thématique et d’attiser notre curiosité.
Les anthologies et les revues couvrent tous les champs littéraires ou non littéraires même si le plus souvent nous sommes dans des formats où le « court » domine : nouvelles, contes ou légendes, brèves, poésies et, pour le « non – fiction » articles, témoignages, chroniques, journaux, colloques, débats, synthèses… Elles sont à ces formats ce que les collections éditoriales sont au romans, essais, et autres dictionnaires ou encyclopédies.
Bien sûr, il y a des exceptions comme l’Avant-Scène, revue publiant l’actualité des théâtres et une pièce représentée dans son intégralité. C’est, pour moi, une revue « livre », la partie « actualité » n’étant que contextuelle. La revue « Théâtre Populaire » avait, en son temps, à peu près le même format avec, en plus des articles de fond destinés à durer.
Il y a aussi des anthologies qui se font régulières et deviennent, pour moi, quasiment des revues comme « Voix Vives de méditerranées en méditerranées » que publient les Éditions Bruno Doucey depuis 2011 et qui présente une sélection de textes des participants au festival éponyme qui se tient, en France, à Sète. Chaque année, je guette la sortie de ce recueil, n’ayant pas l’occasion de me déplacer à Sète pour participer à ce festival. Si, pour beaucoup, la dernière semaine de juillet est synonyme de vacance, pour moi c’est l’une des périodes les plus chargées de l’année. Et puis, soyons francs, je suis un peu agoraphobe et fréquente peu les grands rassemblements. J’aime la convivialité de proximité, une bonne table plutôt qu’un grand salon.
Mais revenons à ce festival qui existe depuis 2010 (pour plus d’informations vous pouvez consulter son site : http://voixvivesmediterranee.com ) et dont les Éditions Bruno Doucey se font l’écho depuis 2011. Et puisque vient de paraître (il y a quelques mois mais je ne suis jamais très proche de l’actualité) la dixième édition de cette anthologie, je me suis dit, l’autre matin en ne me rasant pas, que je me les relirai bien, ne serait-ce que pour voir l’évolution de cette poésie « Voix Vives » et « méditerranéenne ».
Mais tout d’abord, voyons les constantes du format ou, pour le dire autrement, le cadre éditorial, l’écrin où s’épanouissent les textes. Et puisqu’il s’agit de « voix vives » et de « méditerranée » commençons par un peu de géographie.
Chaque volume est construit autour de cinq « continents » méditerranéens : africain, balkanique, latin, oriental, – regroupés dans un chapitre « les quatre Méditerranée » – et un cinquième continent regroupant « la méditerranée dans le monde » à partir de sa diaspora ou son influence culturelle. La « mer à l’intérieur des terres » s’ouvre et dépasse la seule « mare nostrum » chère à l’empire romain. En dix ans, je l’ai vue trainer ses guêtres du Chili à la Suisse, de l’Argentine au Luxembourg, de la Belgique à l’Angola, du Québec au Congo, de la francophonie aux langues méditerranéennes.
Ce panorama est complété d’une section consacrée aux « poètes de l’équipe du festival » et, depuis 2018, d’une autre section « hommage » présentant des textes d’auteurs référentiels récemment décédés, un peu à la manière de la rétrospective des « chers disparus » des Césars et autres académies. Signe d’embourgeoisement ? Peut-être. Ou pas. « Aux poètes, le festival reconnaissant » comme si la mort sacralisait l’œuvre. Pour ma part, j’ai tendance à croire que l’œuvre défie la mort. Celle de Salah Stétié, par exemple, qui ouvre l’anthologie 2020 et rend justice à l’immensité de l’homme qui fut le poète que l’on sait, le passeur infatigable des deux rives méditerranéennes et le président historique du festival.
En 2020, une nouvelle section est arrivée, « Mémoires vives », sans trop d’explication et présentant trois poètes : Paul Valéry, natif de Sète, Federico Garcia Lorca et René Guy Cadou. Sans doute est-ce lié à la programmation des manifestations.
Enfin, la partie éditoriale se termine par un chapitre consacré aux notices biographiques des auteurs présents dans l’anthologie.
Le choix de rejeter en fin de volume ces notices facilite la lecture continue de l’anthologie. Nous passons de poème en poème comme lorsque nous écoutons un disque ou lisons un recueil. On se laisse bercer par ces musiques qui, souvent, nous sont étrangères et nous pouvons « consommer » cette poésie sans trop réfléchir tout à la joie du choc des voyelles, des assonances et des allitérations, de la rugosité des consonnes uvulaires ou vélaires, des enjambements et de la multitude de sens qu’ils procurent, ou, tout simplement, vivre notre plaisir poétique comme nous savourons un thé préparé dans les règles de l’art.
Pour ma part, et pour les anthologies ou les revues qui me sont aussi des espaces d’apprentissages, je préfère l’approche « Seghers » qui introduisait le poème par le contexte de l’auteur. Savoir qu’elle est albanaise est une information, me semble-t-il, trop minimaliste pour comprendre, ressentir, vivre le poème proposé si l’on ne sait pas, par exemple, que l’Albanie était une dictature communiste jusqu’au début des années ’90. Le rejet, in fine, de l’appareil « critique », ne s’entend, pour moi, que lorsqu’il est d’importance et que la note à lire est, parfois, plus importante que le texte, comme dans les éditons de La Pléiade. Ici, il ne s’agit que d’indications biobibliographiques qui mériteraient d’introduire les œuvres. Dans cette disposition actuelle, je n’arrête pas les allers-retours ce qui, vous en conviendrez, ne facilite pas la lecture. D’autant que la présentation des poètes suit une logique alphabétique alors que la présentation des textes suit une logique géographique et lorsqu’il y a deux logiques éditoriales il y en a forcément une de trop.
Enfin, je serais incomplet si je ne précisais pas que tous les textes sont présentés dans leur langue d’écriture et, lorsque nécessaire, dans une traduction française souvent inédite.
Chaque volume se veut le reflet du festival. La liste des pays représentés évolue en fonction de la présence de ceux-ci lors de la manifestation. En 2020, la fermeture de certaines frontières, liée à la gestion de la pandémie de la Covid 19, a impacté et l’organisation du festival et l’édition de l’anthologie. Mais, depuis 2011, chaque année, une centaine de poètes en moyenne, venant d’une quarantaine de pays, sont publiés.
Rappelons ici que le bassin méditerranéen regroupe géographiquement, de Gibraltar à Gibraltar, 23 pays et que ne sont présents, dans les dix premières éditions de cette anthologie, ni le Royaume-Uni (Gibraltar ou les territoires anglais de Chypre), ni Monaco.
Par contre, nous trouvons, dans la section « les quatre Méditerranée » qui décline a priori le pourtour méditerranéen en quatre zones (africaine, latine, balkanique et orientale) l’Iran, le Koweït, le Qatar, le sultanat d’Oman, la Jordanie, le royaume de Bahreïn, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l’Irak, le Kosovo, la Macédoine, la Serbie, la Roumanie et le Portugal.
Sérieusement ?
Je n’ai rien contre l’ouverture, au contraire, mais il y a une rubrique intitulée « La méditerranée dans le monde » alors pourquoi inclure tous ces pays non méditerranéens dans ce chapitre ?
Comment vais-je expliquer à ma mère, 85 ans, que le Portugal a son littoral sur l’Atlantique si vous le classez dans le bassin historique (noch einmal : oriental, latin, balkanique et africain) de notre mer intérieure ?
Que vont dire mes amis vampires en trouvant leurs Carpates les pieds baignant théoriquement dans les eaux de la mer Égée ? Faut-il encore que la Transylvanie traverse la Bulgarie et la Thessalie. La Roumanie n’a qu’une rive, elle est sur la Mer Morte.
Quant à la « Macédoine », j’ai longtemps hésité à l’inclure dans cette hors liste, de quoi parlons-nous ? De la province grecque ? De la région historique et transnationale ? De la République de Macédoine du Nord qui n’a pas de d’accès à la Méditerranée ? De même que la Serbie ou le Kosovo, terres sans mer.
Et que dire de ce groupe des États Arabes du Golfe qui flirtent avec l’océan indien ? À cause des Omeyades de l’Andalus du Xème siècle, lorsque la péninsule ibérique n’était fragmentée ni en région ni en pays ? Le lien date un peu, me semble-t-il, pour les inclure dans ce chapitre consacré aux quatre espaces historiques de la méditerranée.
Ad libitum, comme on dit chez moi quand on n’a plus soif.
Je ne parle pas ici de littératures, ni de poésies, je parle de géographie. Une anthologie, dans son essence, est un outil pédagogique de découverte. En tout cas, je les lis comme tel. Mélanger le périmètre de l’empire romain de Trajan (ou peu s’en faut d’un golfe près et une Angleterre de moins) avec le périmètre physique de la Méditerranée est un mystère pédagogique. Comment peut-on laisser penser que tous ces pays sont, par nature et non par influence, méditerranéen ? Suis-je le seul un tant soit peu géographe que ce classement choque ? A quoi sert de diviser des parties si tout est en tout ? Autant ne rien ordonner.
Et même si, comme moi, on reste persuadé que la géographie n’est que circonstancielle, qu’elle dépend des traités et non des peuples, qu’elle reste liée à l’histoire des civilisations – nous pourrons discuter à l’occasion de la conférence de San Remo et du rôle de la perfide Albion dans le découpage en 1923 du territoire « naturel » de la Jordanie, accessoirement origine, pour moi, du conflit palestino-israélien – il n’en reste pas moins vrai que la Lusitanie a un littoral atlantique et non méditerranéen.
Ceci étant dit, comme je ne comprends pas cette logique, je poursuis ma lecture en espérant que vous poursuivrez la vôtre car, au-delà du cadre, il y a les auteurs et les découvertes que nous pouvons faire dans ces anthologies.
Et pour le coup, cela foisonne ! Une centaine d’auteurs par volume, je l’ai dit, tous contemporains, des hommes, des femmes, des poètes « installés » et des jeunes pousses, des reprises de publications et des inédits, beaucoup d’inédits … j’avais l’intention de tout mettre en fiche, pour vous proposer de belles statistiques, et puis j’ai renoncé. Trop de travail inutile. Les chiffres, pour parler de poésies, cela ne sert pas à grand-chose. Les voyelles, oui, les couleurs, mais les nombres ? Sauf pour un bonhomme à la 6-4-2, calligramme à l’Apollinaire, Collage à la Prévert, rébus, comptine ou suite pataphysique.
Le choix est large, comme les styles qui coexistent. Nous naviguons de proses en vers libres, de l’intime à l’extime, du poème à la guerre, de la ville au désert, toute la nature humaine défile au fil des pages, au long des pauses, argonautes à la recherche de nous-mêmes dans ces autres voix vives qui nous approchent. La poésie est ici philosophie, théâtre, graphique parfois, gratuite toujours, offerte, littérature enfin, qui ne sert à rien et qui nous augmente.
Il est impossible de parler de tout le monde ici et ce n’est pas mon propos. L’anthologie, je l’ai dit, comme la revue, est un plaisir de gouteur. Autant de textes, autant de saveurs, autant de bonheur, autant d’instants volés où je relève la tête pour isoler du livre le poème lu, où je ferme les yeux pour le digérer, où je poursuis ma lecture en attente d’autres émois.
Et comme je ne crois qu’à l’exemplarité (ou presque mais nous parlerons de mes croyances lors d’une autre chronique), voici ma petite anthologie de ces anthologies, sans prétention aucune, juste pour le plaisir.
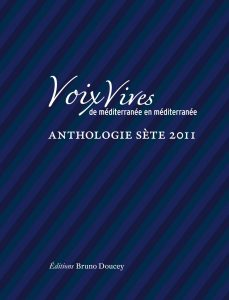
2011 : SYRIE (et un peu France aussi 😉 )
Signe 18
Je te donne une bouche propre
Parfumée de musc
Et de secrets
Je te donne une bouche qui mange
Qui mâche
Qui boit
Qui avale
Je te donne une bouche qui raconte des histoires
Qui clame des poèmes
Qui sourit des métaphores
Et pleure de douleur
Une bouche qui désire
Qui embrasse
Et jouit
Maram al-Masri
Par la fontaine de ma bouche
(Traduction de l’autrice – Éditions Bruno Doucey – 2011)
Maram al-Masri m’accompagne depuis des années, depuis « Cerise rouge sur un carrelage blanc » (2003). Pour moi, elle est sans conteste l’une des grandes voix de la poésie contemporaine. Elle représente la sensualité persane comme je me l’imagine à travers les contes de Shéhérazade. Sa poésie rencontre autant le monde parce qu’elle est vraie. Elle ne joue pas avec les mots, elle imprime son rythme, sa danse, sa vie, et de cette graphie nait le sens.
L’un de ses recueils qui ne me quitte pas et qui, je crois, représente le mieux ce qu’elle est dans mon panthéon littéraire est « Le retour de Wallada » (Éditions Al Manar – 2010 – illustration S. Pignon). Je vous donne une de ses merveilles :
Cité des contes et des oranges
Cité de paix et de chansons
Gagne-moi,
Aime-moi
Laisse-moi jouir du miel de ta salive
Et m’abriter de ta lumière
Oui, je sais, je dépasse le cadre mais ce plaisir-là, que ne puis-je faire ? J’ai le goût du Cantique des Cantiques qui me chatouille l’esprit.
J’écrirai bientôt un « portrait » de Maram al-Masri, juste pour lui dire l’émotion qu’elle m’offre et que je tends, maladroitement, à partager.
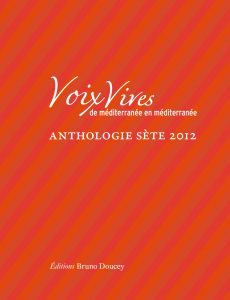
2012 : QUÉBEC
Quand je serai moins vieille,
un soir, je ne rentrerai plus
par les rues, je partirai
la peur pointue me griffera le foie
dans un puisard je jetterai
mes clés une par une
ce sera le début de l’été
avec sa petite herbe verte
un loup sur les yeux
je me coucherai dessus
les utopies bien placées
entre les plis de ma jupe
et j’accumulerai des années
rien qu’à tenir la beauté par la main.
Denise Boucher
(Inédit)
J’avoue, je ne connaissais pas cette autrice et, honte à moi, je n’ai rien lu d’autre que le très beau poème intitulé « disruption » (extrait de « boîte d’image » – Éditions de l’Hexagone – 2016) repris dans l’anthologie « Voix Vives » de 2016. J’aurai dû me précipiter chez mon libraire indépendant et vider ses rayons des œuvres complètes, poétiques mais aussi théâtrales, romanesques voire les quelques quarante et plus participations anthologiques. Mais voilà, mon libraire (indépendant) est allergique à la poésie. Il ne vend que ce qui se vend. Il est libraire « commerçant – indépendant » comme mon primeur qui ne vend que les fruits et légumes fournis par Rungis.
Je pourrais me rabattre sur Amazon ? la Fnac ? Rakuten ? Encore n’y trouverai-je qu’un titre ou deux, Une voyelle (Éditions Leméac – 2007). Les fées ont soif (Éditions Typo Théâtre – 2008), Au beau milieu, la fin (Éditions Leméac – 2011), mais serait-ce bien éthique ?
Bon j’arrête. Vous allez finir par croire que j’en veux aux libraires indépendants de n’être pas tous des défricheurs. Mais nous parlons d’une poétesse reconnue mondialement et, cela n’est pas rien, francophone dans un environnement où la culture est une industrie. Lisez attentivement le texte que j’ai retenu. Relisez-le. Une seule phrase qui court comme l’eau vive ou plutôt comme l’eau de pluie dans la rigole. Une seule phase et autant d’images qui nous saisissent. La « peur pointue » comme un clou dans la chaussure. Cette seule « peur pointue » m’étreint et me noue l’estomac. Elle est « vis » et « râle ». Et ces « utopies bien placées / entre les plis de ma jupe » pour nous rappeler que le rêve de l’homme, de la femme, est d’abord une création, un acte de naissance. Enfin, cette vieillesse à rebours qui débouche sur l’envie de vieillir pourvu que de « tenir la beauté par la main » qui nous donne un but, une philosophie, une éthique, un combat. Regardez, regardez attentivement ce poème. Voyez les enjambements comme autant de pont entre les sens. La pause qui s’en vient, naturellement, en fin de vers et qui peut s’éterniser « par les rues, je partirai », promesse de rupture, « un loup sur les yeux », protéger son intime, ou vivre l’instant et changer le sens de la pensée « par les rues je partirai la peur pointue me griffera le foie », le prix à payer, « un loup sur les yeux je me coucherai dessus », le repos enfin trouvé.
Je retrouve ici la sensation éphémère des rythmes de Verlaine. Une langue sans pareille. Un rêve familier. Que demandez de plus ? Une réédition de ses recueils ?
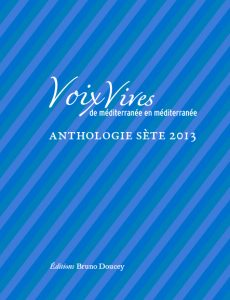
2013 : ALBANIE
Quand le monde s’approche
Quand le monde s’approche, le corps dévoile ses seins,
l’escargot me salue de sa carapace animée de coquelicots.
Avec les plus vieux et les plus impénétrables graphèmes,
les fourmis écrivent une lettre qui m’aime.
Me saisit la nostalgie pour toutes sortes de dieux,
comme pour le cerf qui galope dans le cœur.
Que fait-on de ce surcroît d’amour,
il change le chemin de la vérité,
de lilas en jasmin,
dans le prolongement des fleurs.
Natasha Lako
(Traduction Éva Hila – Inédit)
Encore une découverte et pourtant Natasha Lako publie depuis les années ’60 et a, pour titre de gloire, d’être l’une des seules femmes à avoir écrit durant la période communiste de son pays, période dictatoriale si l’on veut avoir un petit éclairage historique.
En dehors de sa présence dans l’anthologie de Michel Métais consacrée à la nouvelle poésie albanaise (Ismaïl Kadaré et la nouvelle poésie albanaise – Éditions P.J. Oswald – 1973) et bien que son Wikipédia indique la traduction de ses poèmes en français, je n’ai trouvé aucune édition disponible. Et c’est dommage !
Cela étant, je ne sais pas ce que doit le texte à la traduction – on ne dira jamais assez l’importance du traducteur en littérature et, notamment, en poésie. On ne lit, le plus souvent, que l’interprétation du traducteur et, parfois, c’est lui le poète … – mais la juxtaposition des surréalismes animaliers et floraux m’ouvre des perspectives que j’ignorais.
Il est toujours très compliqué de chercher un sens, j’entends un sens commun, un sens universel, à la poésie lorsqu’elle progresse, comme ici, par tableaux. Il y a ici une lecture possible, ma lecture, celle qui n’engage que mon histoire, et qui commence par l’escargot du monde, le jardin zen où le repos est au centre de la spirale, corps fécond, seins dévoilés, plaisirs charnels, langage du coquelicot puis les graphèmes et le travail de fourmis qu’est le métier de vivre, l’écriture qui courre comme le cerf, de nostalgies en mythologies, puisque nous sommes des dieux déguisés en hommes, ou l’inverse. Enfin, l’amour, entre deux délicatesses, deux sensualités qui n’est que questionnement, qui cherche sa place et nous surprend.
Je le sais, en écrivant ceci, je me dévoile. Mais n’est-ce pas le but du jeu ? L’insincérité serait ici impardonnable. Vous dire ce que je ressens en lisant ce poème n’est-ce pas le plus sûr moyen de vous donner envie de découvrir cette autrice ?
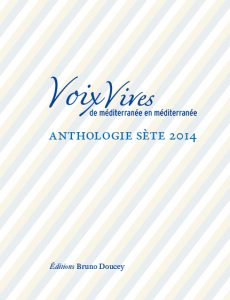
2014 : ESPAGNE
Que serait être toi
Que serait être toi.
Voilà l’énigme, la saisissante attirance
du connaître, l’irrésistible envie de jeter l’ancre
en toi, de te posséder,
Que peut-être la perplexité d’être toi.
Quoi, le mystère, la dolence d’être toi et le savoir.
Quoi, la stupeur d’être toi, vraiment toi et,
avec tes yeux, de me voir.
Que serait percevoir que je t’aime.
Que peut-être, étant toi, me l’entendre dire.
Que serait alors ressentir ce que toi tu ressentiras.
Ana Rossetti
(Traduction Annie Salager – Inédit)
Ana Rossetti est une autrice d’importance qui a publié une quinzaine de recueils de poésies, une bonne dizaine de romans ou recueil de nouvelles, autant de romans jeunesse et d’autres œuvres théâtrales. Aucun livre n’a, à ma connaissance et à ce jour, été traduit en français. Sauf ici. Peut-être qu’un jour, quelque anthologiste ou éditeur nous donnera à lire d’autres textes de cette autrice. Ou peut-être que je tenterai l’aventure d’une lecture directement en espagnole.
Je vois que déjà je fais comme elle, je ne mets plus de point d’interrogation. Parce qu’il n’y a plus de question. C’est de la rhétorique pure. Je suis l’autre comme l’autre est moi. Avec quels yeux me vois-tu. Les miens. Ou les tiens. Ou les tiens devenus miens.
Je ne peux pas m’empêcher de penser à cette chanson, interprété par Serge Reggiani et écrite par sa femme Annie Noël, « Le monsieur qui passe » :
Ça y est ! c’est moi lui, je passe à sa place
Ma peau se défroisse, je deviens charmant
Qu’est-ce que c’est vaste, enfin j’ai de l’espace
Sa tête, ô miracle, me va comme un gant
Pour Ana Rossetti, cette envie d’être dans la place de l’autre est une envie amoureuse, savoir si l’autre que l’on aime nous perçoit comme nous-même ou comme un autre. Cette question m’accompagne depuis mon enfance, sous cette forme ou sous une autre, et de la retrouver là, non plus comme une question mais comme une affirmation interrogative ouvre à nouveau cette porte philosophique et poétique du regard de l’autre et de son pouvoir sur ce que nous sommes.
Mais peut-être qu’il ne s’agit que d’un fantasme autocentré ?
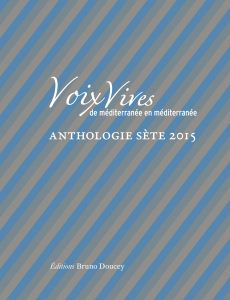
2015 : FRANCE / OCCITANIE
En partance
Plonger dans ses yeux de tendresse et déjà être loin
Sur le chemin du temps
Reprendre souffle sur son cœur et déjà l’horizon en tête
Sur le chemin du vent
Boire à son sourire et déjà l’âme au ciel
Sur le chemin de la solitude
Se ressourcer à la chaleur de sa peau et déjà en partance secrète
Sur le chemin de la liberté
Sylvie Berger
(Traduction de l’autrice – Inédit)
La seule Sylvie Berger que je connaissais était la co-fondatrice du groupe La Bergère dont j’avais eu l’occasion d’entendre le premier album « Ouvarosa » (2002), produit et co-signé par Gabriel Yacoub. De Sylvie Berger, occitane et poétesse, je ne savais rien jusqu’en 2015 et n’en sais pas beaucoup plus depuis si ce n’est qu’elle a ouvert un site Internet avec Serge Desaunay, accordéoniste – violoneux – interprète et compositeur pour promouvoir leurs multiples ateliers.
Ici, à l’évidence, ce qui tend l’œuvre c’est le rythme, la métrique, l’énumération et les répétitions structurelles des phrases. Une action et déjà un mouvement sur un espace : le temps, le vent, la solitude, la liberté. L’histoire d’une rencontre en quatre étapes. Simple. Avec un enjambement qui n’en est pas un. Diptyque qui se cache sous cette forme ramassée et qui accompagne le sens. Et cette fin qui laisse l’instant, l’état du lecteur, interpréter s’il s’agit de rupture ou d’un jardin secret. J’aime à imaginer qu’il s’agit d’un jardin secret, d’un eldorado, ce répit où, parfois l’on s’ensommeille, refuge d’après l’amour charnel, ressource à l’amour spirituel. Mais ne suis-je pas, par nature, optimiste ?
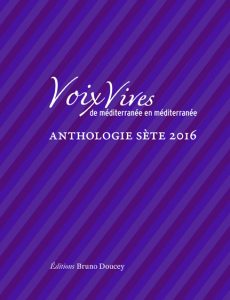
2016 : FRANCE
Je vois la ville …
Je vois la ville de haut
je vois
Les pins parasols à coiffure romantique
ou
pourrait-on dire
aux cheveux ordonnés de garçon sage
ou alors un peu
pompeux
ou généreux d’ombre
selon qui regarde
ces créatures
combien de trous de mots perdus
le temps que je me passionne
que j’oublie ce temps
que j’oublie le compte
que je le dépense
je m’oublie
j’oublie une partie d’aujourd’hui
des trous
ainsi oui
je troue ce temps
je le perds
Sapho
(Inédit)
Marraine du festival « Voix vives… », je ne présente plus Sapho tellement elle est une évidence pour moi. J’ai déjà écrit à quel point sa voix m’était proche, dans ses romans, ses recueils, ses disques et, pour l’avoir vue sur scène, sa présence.
Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, vous pouvez visiter son site. Vous y découvriez l’étendue de son talent.
Pour cette chronique, j’aurais pu choisir n’importe quels textes publiés depuis 2011, elle est l’un des rare poète (l’une des rare poétesses) à être présent dans la quasi-totalité des opus, et tous m’auraient satisfait mais celui-là s’est imposé par son rythme, ses hésitations, l’utilisation du doute comme moteur narratif, et par l’oubli.
Comme toujours, mes choix sont guidés par mes obsessions. Et je me retrouve autant dans cette écriture parce qu’elle entre en résonnance avec mes angoisses d’Alzheimer (qui se souvient de son prénom ?) moi qui suis plutôt an-amnésique.
Et puis qui n’est pas monté en haut d’une tour de guet, d’une cathédrale, d’un beffroi pour regarder les fourmis que nous sommes s’agiter, se rejoindre, se séparer, s’asseoir à la terrasse d’un café, et s’oublier ?
Je referme le volume, relève la tête et déglutis comme une poule ces images lues, m’absente quelques instants dans mes labyrinthes intérieurs puis revient en apnée dans cette musique coulée qui me vague à l’âme.
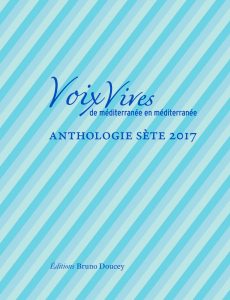
2017 : CHYPRE
Gardiens de pierre
J’ai grandi dans une centaine de maisons
Dans les quartiers du presque rien
C’est pourquoi j’ai peur des colères
Je déteste exercer des pressions sur les gens
À chaque fois que le printemps arrivait
Les crocus embaumaient
Le vin
Les fruits confits
Les broderies
À l’époque où les enfants
Inventaient encore des jeux
L’ânonnement de la beauté
En train de façonner d’étranges statuettes
Du monde du rêve proviennent
Les tendres transparences
Précieuses
De l’enfance
Frosoula Kolosiatou
(Traduction Giannis Ioannou – Inédit)
Je l’ai dit, je suis un promeneur qui aime à se perdre dans la foison des anthologies. L’inconnu m’attire autant que les retrouvailles. Je ne connais rien de Chypre et de sa littérature sauf à me souvenir de Laurence Durell et de ses « citrons acides ». Je serai bien incapable de citer le nom d’un écrivain chypriote, en dehors de Kolosiatou, bien sûr, et des sept autres poètes présents dans les « Voix Vives » de 2011 à 2018. Sans doute parce que l’île est partagée, physiquement par l’enclave anglaise et l’occupation turque, linguistiquement entre ces trois langues et que tout cela ne favorise pas la diffusion des œuvres et pourtant « la poésie chypriote débute avec Homère » écrit Andreas Phylactou dans le N°17 des « Cahiers du Centre d’Études Chypriotes » (et oui, j’ai fait quelques recherches puisque j’aime ;-). C’est dire l’importance, pour moi, de ce berceau.
En dehors de mon ignorance, qui est et restera grande et qui me permet d’avoir encore le plaisir des premiers émois, j’ai choisi ce poème car il m’a frappé de ses parallèles avec nos vies ordinaires, faites de déménagements, de quartiers, de pauvreté, de peurs et d’attentes. Le vin, les fruits, les fleurs, l’enfance et la nostalgie. J’ai tendance à ne pas être « nostalgique », les souvenirs sont précieux mais ne sont pas cet eldorado cher à Candide. Je n’y trouve que la trace de nos vies et non la matière. Ce qui nous façonne est ce que nous sommes, de nos désirs à nos actions. Au présent. Ce temps fugitif. Bien sûr ce que nous avons été est entièrement dans ce que nous sommes et serons. Mais l’idéalisation du passé, ce n’est pas mon truc. Et pourtant, comment résister à « L’ânonnement de la beauté / En train de façonner d’étranges statuettes » ? J’ai les mains dans la glaise, j’ai huit ans, je construis des gardiens d’argile et je m’invente mon Odyssée.
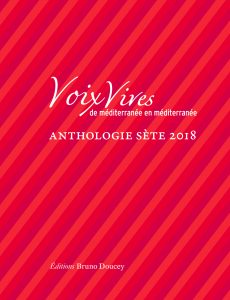
2018 : ITALIE
Les insurgés
Nous fûmes peu ou rien
Puis, nuit et néant
Ce qui n’existait pas
Survenait lentement amplifié
De nombreux autres,
Au nom de celui qui vint
La chair s’abattit sur nous
L’un contre l’autre nous nous serrâmes
Le corps soulevé
Par la force de notre poids
L’humain appelle le mouvement
Chante la nuit adolescente
Le cœur orphelin du néant
Luigia Sorrentino
Olimpia
(Traduction de Angèle Paoli – Edizione Interlina – 2013)
« noi fummo poco o nulla / poi, notte e niente »
La beauté de cette langue n’a pas d’égale. Elle chante. Et la « notte » n’est pas la « nuit ». La « notte » est sous cape, elle nous cache, nous protège. Elle est personnage autant que nous dans cette histoire. Elle intrigue pour se perdre et n’être plus « niente ». Mais la traduction est belle aussi même si, malheureusement, le français manque parfois de contrastes.
Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je lis ce texte je pense à cette chanson « I ragazzi giù nel campo » écrite par Pier Paolo Pasolini et Dacia Maraini et qu’interprétait Anna Prucnal. L’adolescence, la violence, les corps serrés, soulevés, le mouvement, tout cela et le titre, m’évoquent la « caccia ai borghesi », la « chasse aux bourgeois » des années de plomb.
Mais ce passé simple, temps du regret, temps de la nostalgie qui traverse ce poème se différencie du présent des « enfants » de Pasolini. Ce mouvement-là est arrêté pour moi, la nuit n’est plus adolescente.
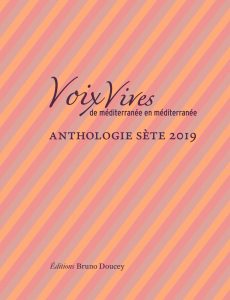
2019 : FRANCE
Comptine pour les petits cochons peureux
1, 2, 3
trois p’tits cochons morts
1, 2, 3, 4
entre leurs quatre murs de pierre
1, 5, 16, 32
laisse souffler
le vent
428, 3800
le loup
migrant
1234567
entre les atomes
de la mer
15, 27, 63
laisse souffler
le vent
629, 3119
le temps
migrant
mélange les frontières
42, 85, 553, 2262
laisse entrer
le loup
le temps
le vent
passant
1,2,3
trois p’tits cochons morts
enfermés
1, 2, 3
queue en tirebouchon
1, 2, 3, 4
entre les quatre murs de pierre
Brigitte Baumié
(Inédit)
J’aime beaucoup le travail de Brigitte Baumié que j’ai découvert avec la première édition de ces « Voix vives » puis avec l’anthologie qu’elle a établie et présentée « les mains fertiles » (Éditions Bruno Doucey – 2015). Participant à l’organisation du festival, je la retrouve chaque année, toujours avec plaisir, dans la section consacrée aux collaborateurs. Pour cette chronique, j’ai choisi cette comptine, d’abord parce que j’avais envie d’un peu de légèreté dans la forme, ensuite parce que, comme toute comptine, elle s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes et que ses niveaux de lectures sont multiples.
Je ne vous ferai pas le coup du décryptage, vous êtes assez grands pour comprendre sans moi ce qui se trame, ce qui se drame, dans cette chanson. Non. Je ne vous parlerai que de rythme, puisqu’enfin, tout est là. « De la musique avant toute chose ». Les comptines ont le même pouvoir entraînant des tables de multiplications, des suites logiques, des nombres premiers, elles s’incrustent dans nos mémoires sans qu’on y prenne garde et nous voilà, dans le métro, en voiture, sur nos vélos à chantonner « 1, 2, 3 / trois p’tits cochons morts ». Nous n’attachons plus d’importance aux paroles, nous nous rappelons juste la ritournelle même si, quelque part, toutes les angoisses, des p’tits cochons peureux que nous sommes, sont tapis dans l’ombre. Ces comptines exorcisent nos Boogie Men.
« J’étais partie ce matin au bois / pour toi, mon amour, pour toi… »
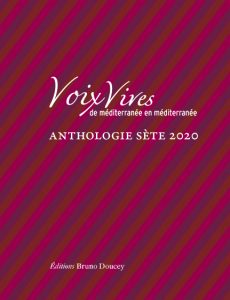
2020 : GRÈCE
Le prétexte
Il y avait les dunes.
La maison qui restait toute seule.
La mer qui glissait sur une plage, toute à elle
et les tamaris qui poussaient éperdument.
Il y avait la lune plus pleine de jour en jour
jusqu’à être rouge comme une boule de glace
qui m’appelait à la goûter.
Et le vent qui amenait le sable aux visages
sable sans poids, doré, humide et collant à la peau.
Et toi qui n’étais pas là, mais remplissait les chambres
d’un amour éperdu comme les tamaris.
Tu n’étais pas là.
Mais tu étais le prétexte.
Lily Michaelides
(Traduction de Michel Volkovitch – Inédit)
Tout minot, j’ai appris à apprécier la poésie avec les fables de La Fontaine, notre maître nous les faisait apprendre par cœur et nous les récitions tout au long de l’année. Je découvris, en étudiant le grec ancien, les fables d’Ésope, les origines, que notre professeur nous faisait apprendre par cœur et que nous récitions à longueur de temps, un peu pour frimer puisque nous n’étions que six dans tout le collège à user nos langues des « kai ouk ekei » comme un cri de guerre. Puis ce fut Homère, Antagoras, Anacréon bien avant Ronsard
Quand je bois du vin, les soucis s’éloignent de moi et les pensées inquiètes s’envolent sur l’aile des vents qui résonnent sur la mer.
puis Sappho, Pindare, cette littérature classique qui fut mes humanités. Et toujours la mer, cette mare nostrum, notre mer à tous qui me berçait.
Il y a ceux qui partent au long court, les Christophe Colomb, les Magellan, les Erik le Rouge de la vie, qui traversent des océans pour trouver leurs ports d’attache. Je n’en suis pas. Je suis comme Lily Michaelides, entre les dunes et la maison, entre la plage et le vent, à caboter dans cette mer intérieure déjà trop grande pour moi. Le cabotage c’est bien. On prend le temps d’une route plus longue. On revient chez soi, parfois après une Odyssée, ou parfois non. Je suis comme Ulysse revenu en Ithaque. Je suis le nid, je suis l’oiseau, je suis la mer, je suis la vague et tout cela n’est qu’un prétexte à vivre.
Oui, je sais, j’ai un peu débordé et cela ne va pas être facile de finir cette chronique. Mais voilà, j’écris au fil de la plume et de l’humeur. J’écris parce que je ne peux pas faire autrement, en espérant que vous prendrez plaisir à me lire, même si je dépasse les deux cent quatre-vingts caractères normatifs de la communication moderne. J’espère que vous apprécierez les voix féminines de cette sélection. Elle est toute relative. Circonstancielle. J’écrirais cette chronique demain et mes propositions seraient différentes. Avec plus de mille poèmes, faites-vous plaisir. Et puisque j’en ai fini ici, je vous laisse avec Sappho, l’autre marraine, qui aura le mot de la fin :
Ses chants étaient beaucoup plus doux que le son de la lyre, et elle était bien plus précieuse que l’or le plus pur…
Les anthologies « Voix Vives » participent à la collection « Tissages » des Éditions Bruno Doucey.